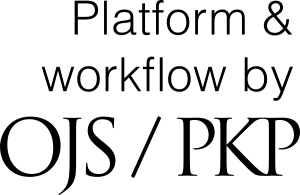Dissolution de toute altérité
Le morphing comme figure absolue de la continuité
Mots-clés :
morphing, métamorphose, parcellarisation, illusion figurative, pictural, fonctionnalité, transitionnelRésumé
En l’espace de vingt ans, la présence de l’informatique s’est imposée dans les arts visuels et les médias au point de littéralement bouleverser le paradigme de l’image et le rapport que celle-ci entretenait jusqu’alors avec l’individu. Si nous prenons comme objet d’étude l’image cinématographique, technique et technologie œuvrent dorénavant de concert allant jusqu’à enrichir la grammaire cinématographique de nouvelles formes filmiques encore inédites. On pense tout particulièrement au morphing qui devient l’incarnation même de l’évolution figurative et de la continuité. Outre son action spécifique sur l’image, il s’attaque directement à l’intégrité des corps et décors qui y sont représentés. Cette nouvelle forme transitionnelle remet en perspective les stabilités jusqu’alors inébranlables de la représentation, ouvrant l’image à l’horizon de la simulation. Il nous semble essentiel de comprendre l’utilisation du morphing et ses incidences sur le spectateur. Nous allons dégager deux principaux emplois, lorsque le morphing est visible et invisible. Dans le premier cas, il serait important de comprendre comment en opérant une transformation à vue, il réactualise le mythe de la métamorphose et questionne la finitude humaine. Dans le second cas, nous proposerons quelques pistes de réflexion sur la manière dont il se fond dans l’épaisseur de l’image pour mettre à jour ses conséquences sur l’altérité et les stabilités de l’image. Enfin, nous nous interrogerons sur l’hybridation généralisée de l’image et son impact sur le statut du signe.
Publié-e
Numéro
Rubrique
Licence

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.